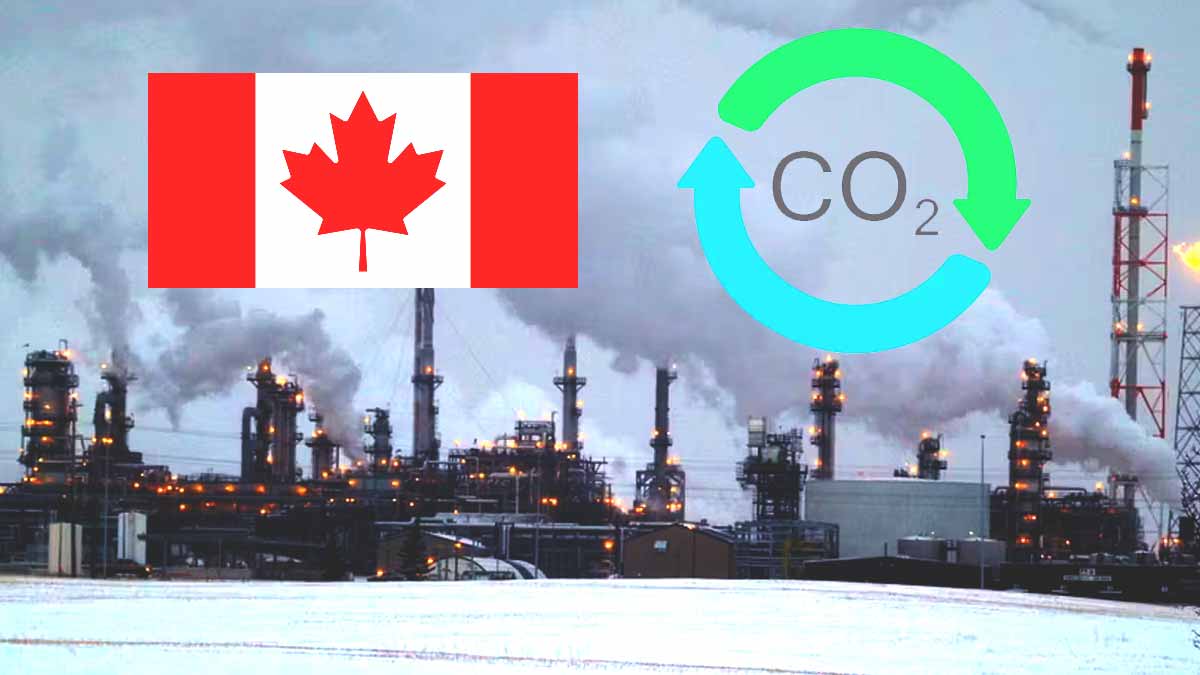Une usine géante au Canada promet d’effacer l’empreinte carbone de 27 millions de voitures grâce à des filtres à CO₂.
Dans le vacarme climatique de ces dernières années, un pays a décidé de faire moins de bruit et plus d’action. Le Canada, souvent discret sur la scène industrielle verte, vient de frapper un grand coup avec un projet qui ne ressemble à rien d’existant. En Colombie-Britannique, une gigafactory de filtres à CO₂ vient de sortir de terre. Pas une usine pilote, pas un prototype. Ici, on parle d’un véritable monstre d’ingénierie conçu pour faire ce que peu d’infrastructures dans le monde savent faire à cette échelle : aspirer le carbone là où il naît, directement à la source.
Une gigafactory de filtres à CO₂ taillée pour les émissions massives
À Burnaby, dans la banlieue de Vancouver, une installation de 13 100 m² vient de lancer ses machines. Son nom, Redwood Manufacturing Facility, pourrait presque évoquer une forêt. Et, dans un sens, c’est un peu ça : une usine pensée pour filtrer l’air, mais avec des outils d’ingénieur. Derrière le projet, une entreprise canadienne baptisée Svante Technologies. Leur idée ? Remettre à l’échelle industrielle une technologie capable d’absorber 10 millions de tonnes de CO₂ chaque année. Pour donner un ordre de grandeur, c’est l’équivalent des émissions de 27 millions de voitures.
Cette gigafactory de filtres à CO₂, la première du genre au monde, s’étale sur 113 000 m². Un gabarit impressionnant, qui ne sert pas la démesure, mais la précision. Ce que produit l’usine, ce sont des filtres à base de MOF, des structures métalliques poreuses aux propriétés extraordinaires. Le genre de matériau qu’on croirait tout droit sorti d’un labo de science-fiction. Capables de capturer le carbone avec une efficacité rare, ces filtres peuvent en plus être régénérés, utilisés encore et encore. Ils prennent la forme de cartouches standardisées, prêtes à être installées dans les conduits d’usines qui fument encore trop.
Cimenteries, aciéries, incinérateurs, centrales au gaz, tout ce que l’industrie compte de sources à forte intensité carbone peut, en théorie, y passer. Et c’est bien là l’ambition de Svante : pas simplement inventer une technologie propre, mais la rendre manufacturable, accessible, scalable. Claude Letourneau, le PDG, résume le projet avec une formule simple : « Ce site de production montre ce qu’il est possible de faire quand la technologie rencontre l’urgence climatique. » Et cette rencontre, visiblement, s’est produite à grande vitesse.
Un pari qui redessine les contours du marché carbone
Cette gigafactory n’est pas juste un coup médiatique. Elle est en réalité l’illustration concrète d’un virage que prend l’industrie mondiale. Le captage du carbone, longtemps cantonné aux études prospectives ou aux sites pilotes, devient une solution industrielle en soi. Et elle attire les gros investisseurs. Redwood a levé 145 millions de dollars américains, soutenus par Chevron, Samsung, GE Vernova, Temasek, United Airlines Ventures et le Canada Growth Fund. Une brochette de partenaires qui donne le ton : cette technologie est attendue, surveillée, et surtout financée.
D’autres projets du même type devraient émerger rapidement. L’objectif est en effet clair : dupliquer le modèle Redwood là où la demande se fait sentir. Amérique du Nord, Asie, zones industrielles européennes… Le monde cherche des solutions, et Svante entend bien fournir les outils. Les filtres sont déjà testés ailleurs : à Kern River, sur une unité Chevron, ou à Richmond, au sein de la cimenterie Lafarge, dans le cadre du programme CO₂ MENT. Même Climeworks, entreprise star de la capture directe dans l’air, intègre cette technologie pour ses nouvelles installations plus sobres en énergie.
Le Canada parie gros sur un futur sans carbone
Ce qui fait la force de cette approche, c’est sa souplesse. Les filtres peuvent être placés en sortie de cheminée ou installés dans des unités mobiles pour absorber le CO₂ directement dans l’atmosphère. Ce sont un peu les couteaux suisses du captage carbone, capables de s’adapter aux besoins très variés d’un monde qui cherche encore à se décarboner sans ralentir.
Et le marché suit. En 2024, le secteur du captage et stockage de CO₂ est estimé à 8,1 milliards d’euros. D’ici 2033, il pourrait dépasser les 23 milliards d’euros. Une croissance à deux chiffres, portée par la pression réglementaire, l’essor de l’industrie verte et des projets de plus en plus ambitieux. De la Norvège au Danemark, de l’Australie à la Chine, en passant par les réseaux de transport transfrontaliers en Europe, c’est toute une infrastructure mondiale qui se met doucement en place.
Évidemment, il reste un long chemin à parcourir. Même à plein régime, la capacité actuelle de ces projets reste bien en dessous des volumes qu’il faudrait retirer pour infléchir sérieusement la courbe climatique. Mais une chose est sûre : le mouvement est lancé. Et la gigafactory de filtres à CO₂ de Redwood en est l’un des symboles les plus visibles.